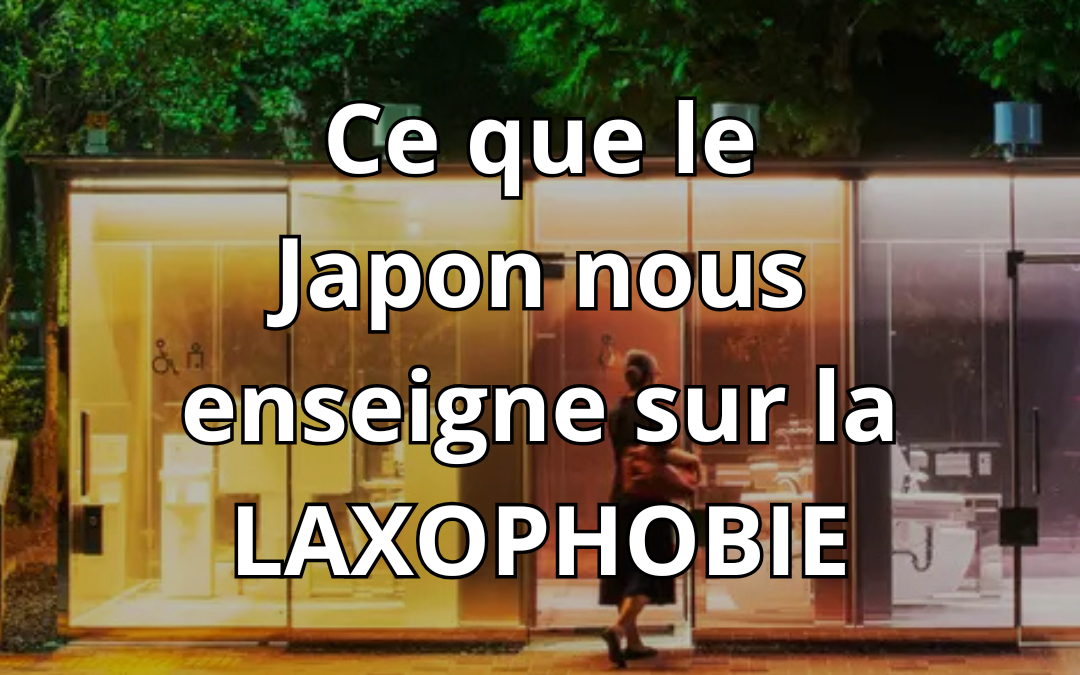Gestion de Conflit au Travail : La Clé n’est pas la Logique, mais l’Émotion.
Gestion de Conflit au Travail : La Clé n’est pas la Logique, mais l’Émotion.
Vous êtes manager ou dirigeant et vous sentez la tension monter dans votre équipe ou avec un collaborateur ?
Un simple désaccord sur un projet qui se transforme en un affrontement personnel ?
Vous avez l’impression de passer plus de temps à gérer des susceptibilités qu’à avancer sur vos objectifs ?
Rassurez-vous, c’est une situation que tous les managers connaissent. Le problème n’est souvent pas votre logique ou vos arguments, mais une mécanique cérébrale puissante qui nous dépasse tous.
Dans cet article, je vous dévoile pourquoi les conflits s’enlisent et vous transmets la méthode la plus efficace pour les désamorcer : une approche qui consiste à arrêter de vouloir convaincre avec la raison pour commencer par adresser l’émotion. Une compétence clé que je travaille en coaching avec les dirigeants et les managers que j’accompagne.
Le Point de Bascule : Quand le Conflit Devient Personnel
Dans le monde professionnel, les désaccords sont inévitables. Le point de bascule crucial se produit lorsque la discussion quitte le terrain du problème pour se centrer sur l’individu.
Lorsque des tensions apparaissent, il est fréquent de voir les parties impliquées passer d’une analyse objective du problème à une perception subjective et souvent négative de l’autre personne. Les réflexions deviennent alors « C’est un incapable », « Il me veut du mal », ou encore « Elle refuse mon autorité » pour un manager.
Cette personnalisation du conflit est un signe que notre cerveau émotionnel et archaïque a pris le dessus.
Ce mécanisme est décrit comme l’activation du Système 1 de pensée : rapide, intuitif et basé sur nos émotions, par opposition au Système 2, plus lent et rationnel.
Face à une opinion divergente ou un désaccord, notre cerveau primitif peut interpréter l’autre comme une menace, un « prédateur » potentiel. Cette réaction de défense, héritée de nos ancêtres, nous pousse à nous protéger et à diaboliser l’adversaire.
En conséquence, au lieu de chercher des solutions au problème, l’énergie est dépensée à justifier notre propre position et à attaquer celle de l’autre. Le conflit s’ankylose, alimenté par des jugements de valeur et des interprétations négatives, rendant toute collaboration ou compromis quasi impossible.
Comprendre que la perception de l’autre comme un « ennemi » est souvent une réaction primaire de notre cerveau, et non une réalité objective, permet de prendre du recul et de réorienter le dialogue vers le problème initial.
Pourquoi vos Tentatives de « Raisonner » l’Autre Échouent ?
En tant que manager, votre réflexe est sûrement d’essayer de ramener le calme en recentrant le débat sur les faits et la logique. Pourtant, vous constatez que cela ne marche pas, et que le conflit s’intensifie même.
L’erreur que je vois le plus souvent chez les managers que j’accompagne est de vouloir parler au Système 2 (la raison) alors que c’est le Système 1 (l’émotion) qui est aux commandes. C’est comme essayer de faire des maths avec une personne en pleine crise d’angoisse : sa capacité d’analyse objective est paralysée.
Les émotions dominent, et la capacité à penser de manière claire et objective est largement altérée.
Dans ces moments-là, c’est le Système 1, le cerveau émotionnel et archaïque, qui est aux commandes. Les personnes se sentent attaquées, menacées, et réagissent avec des mécanismes de défense primitifs. Voir l’autre comme un « prédateur » n’est pas une simple métaphore, c’est une réalité psychologique intense qui paralyse toute tentative de résolution rationnelle.
La Clé : Plonger dans l’Émotion pour Mieux en Sortir
La solution efficace, bien que contre-intuitive, est d’adresser la charge émotionnelle en premier. Ce n’est qu’une fois l’émotion apaisée que la porte de la logique pourra se rouvrir.
Voici les différentes compétences que j’enseigne en coaching aux managers et dirigeants
Développer l’empathie managériale et désamorcer la charge émotionnelle
L’objectif primordial est que la personne en face de vous se sente profondément comprise ce qui désamorce la défensive et ouvre la voie à la confiance et à la révélation d’éléments de compréhension.
L’empathie managériale est la capacité à identifier, comprendre et articuler le point de vue et les émotions de l’autre personne, même si vous n’êtes pas d’accord. Elle n’est ni de la sympathie, ni de la compassion.
Ce sentiment de compréhension désamorce instantanément la défensive et ouvre la voie à la confiance et à la révélation d’éléments cruciaux pour la résolution.
Pour y parvenir, plusieurs techniques sont essentielles :
-
-
- L’étiquetage émotionnel: Des études en psychologie ont démontré que le simple fait de nommer les émotions négatives tend à réduire l’activation de l’amygdale, la partie du cerveau associée à la peur et aux réactions de stress. Utilisez des phrases telles que « On dirait que vous êtes en colère » ou « On dirait que vous hésitez… ».
-
-
-
- La projection du point de vue : Mettez-vous activement à la place de l’autre pour essayer de comprendre comment il voit les choses et ce qui est important pour lui. Cela se traduit par des phrases comme : « On dirait que pour vous, il est important de… » ou « Vous êtes quelqu’un qui cherche à faire de l’excellent travail, et pour vous, cela passe par… ».
-
Que ce soit pour l’étiquettage émotionnel comme la projection de point de vue, ne jamais dire « je » qui ramène vers soi et activera les défenses de l’autre « j’ai l’impression que tu/vous », « je ressens que tu es en colère », (les adeptes de la CNV n’aimeront probablement pas ce que je décrit ici…)
-
-
- C’est aussi l’occasion de lister mentalement toutes les accusations ou perceptions négatives qu’il pourrait avoir à votre égard ou envers la situation (« Vous pensez peut être que je n’y connais rien, que je ne cherche qu’à vous imposer mon point de vue … »… »). En les anticipant, vous pouvez les valider sans les justifier, ce qui renforce le sentiment de compréhension.
-
-
-
- Le ton de voix : Votre ton de voix est un outil puissant. Maintenez une voix calme et posée, articulée, en laissant des silences, avec des intonations descendantes à la fin des phrases. Cela aide à créer un environnement apaisant et à projeter une aura de sérénité, même face à l’agressivité ou à la tension.
-
L’écoute active
La plupart des gens n’écoutent pas vraiment ; ils écoutent pour contrer, pour formuler leur prochaine argumentation, plutôt que pour comprendre. L’écoute active est le contraire : elle consiste à se concentrer pleinement sur ce que dit l’autre, non seulement les mots, mais aussi le ton, le langage corporel.
-
-
- Les « reflets » : Répétez les derniers mots importants ou les idées clés prononcées par l’autre. Par exemple, si la personne dit « Je suis épuisé par la surcharge de travail », vous pourriez répondre : » par la surcharge de travail… ? » Cela l’invite à s’ouvrir davantage et à se livrer, montrant que vous êtes attentif.
-
-
-
- Les résumés : Reformulez ce que vous avez compris des propos de l’autre pour vous assurer d’avoir bien saisi sa perspective et pour qu’il le constate. L’objectif est d’obtenir de l’interlocuteur un « C’est vrai », signe qu’il se sent réellement compris et que la barrière émotionnelle commence à s’estomper, permettant un terrain plus propice à la discussion.
-
-
-
- Éviter le « Pourquoi » : Il est crucial d’éviter les questions commençant par « Pourquoi ». Elles sont souvent perçues comme accusatrices et peuvent mettre la personne sur la défensive, la poussant à justifier sa position plutôt qu’à explorer des solutions.
-
Passez de la confrontation à Rendre l’autre actif dans la résolution du problème
Une fois l’émotion désamorcée, il est temps de rendre votre collaborateur actif dans la recherche de solution. Pour cela, utilisez des questions ouvertes calibrées qui commencent par « Comment » ou « Quoi ». Elles sont perçues comme une invitation à la collaboration, contrairement au « Pourquoi » qui peut sembler accusateur.
Qu’est-ce qu’une question calibrée ?
Une question calibrée est une question ouverte qui ne peut pas être répondue par un simple « oui » ou « non ». Elle commence presque toujours par « Comment » ou « Quoi ». L’objectif est de forcer l’interlocuteur à réfléchir en profondeur et à formuler une réponse élaborée. Contrairement au « Pourquoi » qui peut sonner accusateur et mettre sur la défensive, les « Comment » et « Quoi » sont perçus comme des invitations à la collaboration et à l’explication.
À quoi servent les questions calibrées ?
Les questions calibrées sont utilisées pour rendre l’autre actif dans la résolution du problème en dirigeant sa réflexion. Elles permettent d’atteindre plusieurs objectifs clés en négociation et en communication :
-
- Extraire des informations cruciales : En demandant à l’autre de s’expliquer, vous obtenez des détails sur ses motivations, ses priorités, ses contraintes et ses peurs. Ces informations sont vitales pour comprendre pleinement sa position et identifier les leviers potentiels.
- Orienter la pensée de l’autre : Plutôt que de proposer directement des solutions ou de confronter des arguments, vous amenez l’autre à considérer des aspects spécifiques de la situation. Vous posez des questions qui l’encouragent à réfléchir à des solutions ou à des obstacles que vous souhaitez qu’il prenne en compte.
- Engager l’autre dans le processus : Lorsque l’autre partie doit réfléchir et verbaliser ses pensées, elle s’investit davantage dans le processus de résolution. Elle passe d’un rôle passif à un rôle actif, ce qui augmente son adhésion aux solutions qui émergent.
- Faire avancer la négociation : Si une discussion est bloquée, une question calibrée peut relancer le dialogue en demandant à l’autre comment il envisage de progresser, de mettre en œuvre un accord, ou de surmonter un obstacle. Elle transforme un « non » ou un silence en une opportunité d’exploration.
- Préparer le terrain pour l’accord : En amenant l’autre à formuler ses propres solutions ou à exprimer ses propres contraintes, vous facilitez l’atteinte d’un accord mutuellement acceptable, car il aura l’impression d’avoir contribué activement à sa conception.
Exemples de questions calibrées :
Voici quelques exemples de questions calibrées et leur effet :
-
- « Comment sommes-nous censés faire cela ? » (Invite l’autre à trouver une méthode de mise en œuvre.)
- « Qu’est-ce qui est important pour vous dans cette situation ? » (Dirige la réflexion sur ses priorités fondamentales.)
- « Comment pouvons-nous faire en sorte que cela fonctionne pour nous deux ? » (Pousse à une réflexion collaborative sur des solutions mutuellement bénéfiques.)
- « Qu’est-ce qui vous a amené à cette conclusion ? » (Demande une explication du raisonnement de l’autre.)
- « Comment pensez-vous que nous devrions gérer cela ? » (Met l’autre en position de proposer une voie à suivre.)
En maîtrisant l’art de poser des questions calibrées, vous ne forcez pas l’autre à vos vues, mais vous le guidez subtilement à travers sa propre réflexion pour qu’il devienne un participant actif et constructif dans la recherche d’une issue favorable.
Ce qu’il faut retenir
Gérer un conflit ne consiste pas à gagner un débat, mais à désamorcer une réaction émotionnelle de défense. En comprenant que vous devez d’abord parler au « cerveau émotionnel » de votre interlocuteur, vous changez radicalement votre approche. L’écoute, la validation des émotions et les questions collaboratives sont vos meilleurs outils.
Vous vous sentez dépassé ? Le coaching de manager et dirigeant est là pour ça.
Mettre en pratique ces techniques en pleine tempête demande de la méthode, de l’entraînement et du recul. C’est précisément mon rôle en tant que coach professionnelle.
J’accompagne les managers comme vous à développer ces compétences pour transformer les conflits en opportunités de renforcer leurs équipes.
Vous souhaitez développer votre leadership et gérer les situations tendues avec plus de sérénité ?
Vous pouvez réserver une première séance ou un appel exploratoire gratuit.
Nous discuterons de vos défis et verrons comment un accompagnement personnalisé peut vous aider à atteindre vos objectifs.